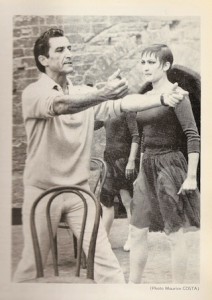Quelle langue parle l’inconscient ?
« Une traduction qui se veut littérale demeure lettre morte… » écrivait Jacques Hassoun dans L’exil de la langue.
Une langue en exil, une langue perdue, comme une mère, comme une patrie. Henri Bauchau a nommé un de ses personnages de roman : Mèrence. Il a composé ce terme avec les mots « Mère » et « Absence », comme pour souligner le lien étroit de l’étranger à la mère, aussi bien à sa mère qu’à sa patrie, la mère-patrie. Mèrence est la figure imaginaire et tutélaire de l’enfance, « la Sibylle » protégée par son langage énigmatique, langage qui la met à l’abri de toute contestation ultérieure. Comme si la figure de la mère ne pouvait être que défigurée dans la langue…
D’où vient que le pays du père se dise : mère-patrie ?
Ici, en France, des patients de langue allemande souhaitent faire leur psychanalyse en allemand. Mais pourquoi ici, en France ? Parce qu’ils y habitent après leur retraite professionnelle ? Se retirer de la « mère patrie » pour mieux se rapprocher de la langue maternelle ? En menant cette réflexion nous n’oublierons pas que Kleist bégayait en allemand (sa Muttersprache) et pas en français…
S’intéresser à cette traversée des langues pour entrer dans le travail — le travail du Réel qui interroge le sujet dans toute l’épaisseur de son histoire…
Ce séminaire a lieu chaque troisième lundi du mois, chez Michèle Jung, en Avignon
(La pratique de la langue allemande est indispensable)
Première séance, le lundi 16 janvier 2012
Contact : Michèle Jung, 06 82 57 36 68, michele.jung@kleist.fr
Synthèse des 6 séances de janvier à juin
Nous avons souhaité, cette année, travailler sur les motivations de nos patients allemands commençant une analyse en France, mais dans leur langue maternelle.
Une première question s’est posée : pourquoi avaient-ils besoin de se retirer de la « mère patrie » pour mieux se rapprocher de leur langue maternelle ? Pour tenter d’y répondre, nous nous sommes intéressée à la traversée des deux langues qu’ils pratiquaient, l’allemand et le français, traversée nécessaire pour entrer dans le travail d’analyse — autrement dit, dans le travail du Réel qui interroge le sujet dans toute l’épaisseur de son histoire…
Dans cet espace particulier de l’entre-deux, du seuil, du déséquilibre de l’identité, de l’éloignement plus ou moins consenti de la langue maternelle, nous avons pu remarquer que le sujet a pu changer la figure de son symptôme sans le déplacer. L’écart entre les langues stimule la pensée, déclenche la réflexion, ouvre des perspectives inédites, c’est-à-dire un travail de suppléance de lalangue de l’exil à lalangue maternelle. Radu Turcanu1 dit au sujet de Cioran : « Il s’agit (…) d’alléger la jouissance, et donc la souffrance qui l’envahissait dans cette langue maternelle ».
Rappelons que c’est à partir du séminaire Encore, en 1972, lorsque Lacan écrit : « l’inconscient est structuré comme un langage » (revoir sur ce site nos travaux de 2006-2007), qu’il parle de la lalangue : langue maternelle, langue parlée et entendue par le jeune enfant, langue des affects dans laquelle s’est constitué le symptôme, langue qui joue un rôle essentiel dans la structuration de l’inconscient.
L’an prochain, en 2013, nous souhaitons reprendre une recherche sur lalangue de Freud entamée il y a quelques années. « Intellectuel déraciné », disait-il de lui-même, dans la quête éperdue d’une langue qu’il ne connaissait pas. (Il a quitté Freiberg (en Moravie) à 3 ans pour aller vivre à Vienne)…
Bibliographie
- Jacques Hassoun : « L’exil de la langue ». Point. Hors Ligne, Paris, 1993.
- Colette Solers. L’énigme du savoir. PUF, 2011.
- Bernard Hoepffner. L’exil de la langue.
- Jacques Derrida, Catherine Malabou. La contre-allée, Voyager avec Jacques Derrida. Essai, 1999.
- La parole et l’écrit dans la psychanalyse. Champ lacanien. Revue de psychanalyse N° 10, page 118.
- Jacques Lacan. Encore Séminaire Livre XX. Seuil.
Michèle Jung
Avignon décembre 2012
1In : La parole et l’écrit dans la psychanalyse. Champ lacanien. Revue de psychanalyse N° 10, page 118.



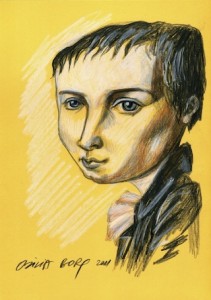


 Je ne résiste pas au plaisir de vous raconter cette anecdote, envoyée à
Je ne résiste pas au plaisir de vous raconter cette anecdote, envoyée à