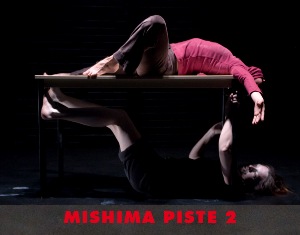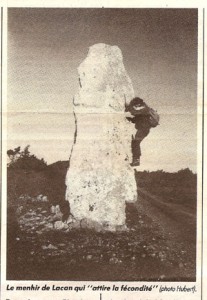« Ein Traum, was sonst ? » sagt Kottwitz zu Homburg
Eine Realität, was sonst… ?, habe ich diese Replik parodiert, als ich am letzten Dezember diese Theaterveranstaltung verlassen habe.
Es gibt mythische Werke, die durch Erinnerungen, durch Phantome von Schauspielergestalten und durch Schatten von Regisseuren, durch Polemiken, wie mit einem Heiligenschein umgeben sind… Kaum wagt man es, sie anzurühren, gerade nur von ihnen zu träumen. Ein solcher Fall ist das Stück « Der Prinz von Homburg » von Heinrich von Kleist, das uns ein Dilemma erzählt, wie man es bei Corneille finden kann. Für den Prinzen dieses Abends (Gilles Chabrier) hatten alle im Zuschauerraum des Theaters Jean Vilar de Romans — ob Mann oder Frau — die Augen von Chimène. Kleist hätte seinen Gefallen daran gefunden. Es muß noch erwähnt werden, daß die Inszenierung von Françoise Maimone war.
In diesem von Heinrich von Kleist 1811 geschriebenen Stück gibt es nicht den Traum und die Realität. Es gibt nicht einmal Tagtraum, sondern zwei Realitäten.
Für diejenigen, die sich über den tieferen Sinn des Textes getäuscht hätten, möge daran erinnert werden, daß wir, in diesem Stück, in dem Preußen von 1811 sind. Wir befinden uns in einer historischen Situation, die für die Zeitgenossen Kleists heilig ist, denn das Kurfürstentum Brandenburg ist eben in Folge dieses Sieges von Fehrbellin über die Schweden zu Preußen gekommen.
Ist Homburg heroisch, weil er den Gehorsam verweigert hat, oder weil er am Ende gehorcht hat ?
Macht Kleist eine Apologie der Staatsvernunft, oder denunziert er die Vernichtung des Individuums durch die Macht ?
Beides trifft zu — und genau dies verleiht dem Text seine Stärke. Françoise Maimone hat ihn inszeniert, ohne sich um irgendeine politische Dimension zu kümmern. Sie hat uns mit dem Universum Kleists vertraut gemacht, sehr weit entfernt von allen Klischees. Kleist, der sich selbst als « unaussprechlich » bezeichnete, ist nicht zu politischen Zwecken zu benutzen — an « Kein[em] Ort …Nirgends » würde Christa Wolf sagen..
Françoise Maimone huldigt ganz einfach diesem Erben des Aufklärungszeitalters, der vor allem dessen Dämmerung erforschte ; und Gérard Maimone unterstreicht dies mit seinen » Éclats nocturnes » am Klavier und Cello.
Die Musik war ja für Kleist eine Hilfe gewesen. Er hat sogar folgende seltsame Worte geschrieben : » … so habe ich, von meiner frühesten Jugend an, alles Allgemeine, was ich über die Dichtkunst gedacht habe, auf Töne bezogen. Ich glaube, daß im Generalbaß die wichtigsten Aufschlüsse über die Dichtkunst enthalten sind » (À Marie von KLEIST, Berlin, été 1811)
Die Szenographie von Brigitte Bosse-Platière schafft einen einzigen und zeitlosen Ort, der den Raum strukturiert, in dem Kleist mit der Welt abrechnet. Reine, einfache, dunkle Linien, die durch die Dämmerbeleuchtung von Stephan Meynet hervorgehoben werden. In der preußischblauen Nacht kennzeichnen die Kostüme von Florenz Demingeon jede Figur. Der Prinz ist etwas eingeengt in dem Seinigen, genauso wie Kleist in seinem eigenen Leben, zwischen Gesetz und Gefühl hin- und hergerissen.
Kleist stellt tatsächlich mehr als einhundert Jahre im voraus, die These auf, die Georges Bataille eindeutig formulieren wird, nämlich dass die Worte schwer ausdrücken, was sie letzten Endes zu sagen haben : das Wort leugnet das Ziel, das — unaufhörlich verneint — der « pulsionnellen » Maschine immer wieder neuen Aufschwung ermöglicht.
Was Kleist wollte, ist eine Rede, die ihr Ziel erreichen würde ; das ist ein Schicksal des Triebes, wo sein Gegenstand mit seinem Ziel zusammenträfe, das ist eine Wirkung der Sprache, wo die menschliche Rede nicht mehr Rede des Wortmangels wäre, sondern Rede von « effectuation », von Verwirklichung. Dies ist jedoch exakt das, woran er leidet und woran auch seine Figuren leiden : Einsamkeit, Unmöglichkeit, etwas mitzuteilen ; Unmöglichkeit mit der Sprache selbst die Wahrheit des eigenen Seins zu erfassen, dennoch wird die Wahrheit in bestimmten Momenten mit Bewußtsein empfunden. Die Inszenierung von Françoise Maimone hat einen Raum geschaffen, in dem diese Sprache, die für Kleist so charakteristisch ist, wahrgenommen und verstanden werden kann.
Als Übersetzung wurde die von Pierre Deshusses und Helene Kuhn. gewählt. Eben in diesem Französisch hätte Kleist sein Stück schreiben können, wenn er es in dieser Sprache — die er sehr gut sprach — geschrieben hätte…
Sich von den gegebenen Hinweisen führen zu lassen, angesichts der Abwesenheiten zu schwanken, sich in die Falle locken zu lassen, Gewitter über sich ergehen zu lassen… ja, das habe ich genossen, ohne zu merken, wie die Zeit vergeht…
Ornella, Avignon, 1er juin 2009
Lire la version française