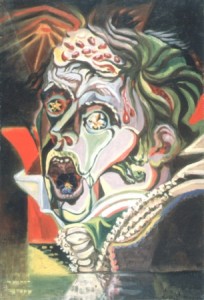Proposition de Michèle Jung pour un groupe de travail
Annonce
En 2006, souhaitant traduire (en allemand) cet aphorisme de Lacan : « L’inconscient est structuré comme un langage », nous avons — au terme d’une réflexion collective — choisi de traduire « comme » par « als » et non par « wie ». « Comme » étant le mot qui faisait question.
En 2007, les apports de chacun ont déplacé notre attention sur le mot « inconscient ». Et — à cette place là de l’aphorisme — s’est imposé le terme « préconscient ». C’est sur ce terme, et uniquement, que nous avons travaillé en 2008.
Dans le chapitre : « Die Vieldeutigkeit des Unbewußten und der topische Gesichtpunkt » de Zur Technik der Psychoanalyse und zur Metapsychologie, nous avons retenu une définition satisfaisante (à ce stade du travail) du Préconscient, donnée par Freud lui-même.
C’est sur ce document — et à partir du chapitre VI : « Der Verkehr der beiden Systeme » — que nous poursuivrons notre lecture cette année 2009.
Ce Séminaire aura lieu le 3ème lundi du mois à Avignon (Vaucluse), à 20 heures
Première séance le lundi 19 janvier 2009
Contact : Michèle Jung – 06 82 57 36 68 – michele.jung@kleist.fr
Nous travaillerons sur les textes suivants :
- Zur Technik der Psychoanalyse und zur Metapsychologie. Internationaler Psychoanalytischer Verlag. Leipzig, Wien, Zürich, 1924. 275 pages.
- Aus den Anfängen der Psychoanalyse. Brief an Wilhelm Fließ, du 6 décembre 1896.
- Entre autres…
La pratique de la langue allemande est indispensable.
Synthèse du travail effectué
de janvier à juin 2009, 6 séances
Comme nous l’avions annoncé dans la présentation de notre Séminaire 2009, nous avons continué à travailler — au plus près de la langue de Freud — la distinction qu’il fait entre préconscient et inconscient. Restait à lire et à commenter le dernier chapitre de Zur Technik der Psychoanalyse und zur Metapsychologie[1], à savoir le chapitre VII : « Die Agnosierung des Unbewußten » (L’identification de l’inconscient).
L’introduction des notions de «Sachvorstellung ou Dingvorstellung », comme on préfère, et de « Wortvorstellung» nous a permis de comprendre en quoi une représentation consciente se différencie d’une représentation inconsciente. « L’une et l’autre ne sont pas, écrit Freud, comme nous l’avons estimé, des inscriptions distinctes du même contenu en des lieux psychiques distincts, ni non plus des états d’investissement fonctionnels distincts au même lieu, mais la représentation consciente comprend la représentation de chose plus la représentation de mot afférente, l’inconsciente est la représentation de la chose seule (die Unbewußte ist die Sachvorstellung allein) ».
Et alors… tout naturellement, tout simplement, « le système Pcs apparaît du fait de cette représentation de chose est surinvestie de et par la connexion avec les représentations de mot lui correspondant. Ce sont, nous pouvons le présumer, ces surinvestissements qui entraînent une organisation psychique supérieure, et qui rendent possible le relais du processus primaire par le processus secondaire régnant dans le Pcs. (…) La représentation non saisie en mots, ou l’acte psychique non surinvesti restent alors en arrière dans l’Ics, en tant que refoulés ».
Pour clore définitivement ce sujet, nous dirons que si « L’inconscient est structuré comme un langage », c’est certainement de l’inconscient descriptif — qui comprend le préconscient — dont il s’agit, et pas de l’inconscient refoulé.
En parodiant Freud, je dirai : « Si nous avons effectivement identifié l’Ics et déterminé correctement la différence d’une représentation inconsciente d’avec une préconsciente, nos investigations de cette année n’auront pas été vaines ».
Michèle Jung
Avignon, le 20 décembre 2009
__________________________________
[1] Internationaler Psychoanalytischer Verlag. Leipzig, Wien, Zürich, 1924, pages 232 à 241.