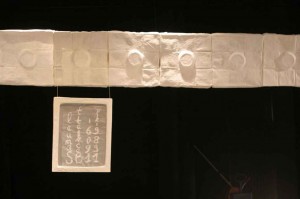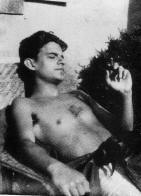Ordet (La Parole, en danois). De Kaj Munk. Traduction Marie Darrieussecq. Mise en scène Arthur Nauziciel.
Ordet apparaît aujourd’hui comme une pièce aux limites du mysticisme, et comme une formidable réflexion sur les forces de vie qui, dans chaque existence d’homme, s’opposent aux forces de mort. Il faut vivre encore et toujours, se battre encore et toujours, aimer encore et toujours… pour ne plus être inconsolable face à l’inexorable dénouement.
En ce 9 juillet 2008, nous sommes dans la Cour intérieure de l’école d’Art, le foyer des spectateurs du 62e Festival d’Avignon. À la tribune : Arthur Nauziciel. accompagné de Catherine Vuillez (Inger) et de Benoît Giros (le docteur) vont répondre à nos questions.Car, hier soir, nous avons vu « Ordet » au Cloître des Carmes.
Tout d’abord, les spectateurs ont — pour la plupart — vu et aimé le spectacle, et ils le disent tous en préambule. Ils ont aimé le texte (même si l’un d’entre eux l’a trouvé « ringard »), la mise en scène, la distribution, l’Ensemble Organum, la chorégraphie de la procession, l’adaptation de Marie Darrieussecq.
L’adaptation… justement. Marie D. n’a pas cherché à « faire » contemporain. Elle a cherché à créer une langue pour le théâtre et non pour une conversation. Elle a cherché à travailler la langue pour que les mots prononcés puissent être portés par l’imaginaire des acteurs et par celui des spectateurs. « Étrange », dit un spectateur. « Être ange !» , dit Arthur N.
La religion… Une spectatrice dit : « Je venais trouver cet amour humain dont la presse avait parlé, je n’ai trouvé qu’une pièce religieuse… ». Son voisin, lui, a vu exactement l’inverse : le thème central n’étant pas la religion mais la foi. La foi en la vie. Un peu après, Arthur N. dira : ne confondons pas laïc et athée. Oui, tout est dans ces nuances, essentielles, car nous sommes des êtres de langage. Et la langue… la parole… le Verbe… Ordet. Un spectateur, qui s’« excuse » d’être théologien, nous parle du rôle interprété par Pascal Greggory (Mikkel Borgen, père). Belle, très belle réflexion.
Puis, pourquoi aux Carmes, alors que la Cour avait été proposée à Arthur N. ? Justement, parce que dans La Cour, devant ce grand mur, les acteurs auraient été de petits personnages soumis au divin. Aux Carmes, ils sont dans un rapport quasi horizontal avec Dieu : l’espace du Cloître des Carmes permettait la circulation de la parole entre la scène et la salle.
Il est aussi question du film de Dreyer. Arthur N. dit : « Le cinéma c’est la mort au travail. Le théâtre, c’est la résurrection ». De la résurrection, il en sera beaucoup question. Des miracles. De la souffrance. De la croyance, aussi.
De la croyance… Octave Mannoni avait porté un regard psychanalytique sur cette notion, c’était dans son célèbre article : « Je sais bien, mais quand même… ». Ce fut pour moi, après cette causerie, un plaisir de le relire ; de relire aussi, par association, ce qu’il écrivait sur ce qui soutient la croyance des spectateurs au théâtre.
Ce que j’aimerais souligner aujourd’hui, c’est que Kaj Munk est né en 1898, qu’il écrit Ordet en 1925, qu’après l’invasion du Danemark en 1940, il devient un farouche opposant au nazisme, et qu’il sera arrêté et exécuté par la Gestapo en 1944. En regard — et pour « justifier » mon retour à la psychanalyse, j’aimerais souligner que Freud emploie pour la première fois le terme de psychanalyse en 1896, que c’est sur « die Verleugnung » qu’il écrit en 1927 que Mannoni s’appuie pour écrire l’article sus-cité, et qu’en 1938 il devra se réfugier à Londres pour fuir le régime nazi. Coïncidences…
Ce 62e Festival a commis d’autres auteurs qui ont écrit au moment où Freud mettait ses observations en mots. Pour l’illustrer, j’espère avoir le temps d’écrire une « critique » sur August Stramm et ses « Feux ».
Michèle Jung, Avignon juillet 2008