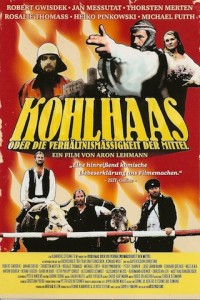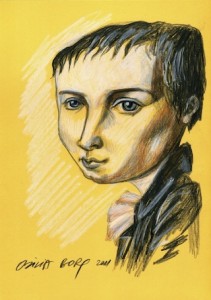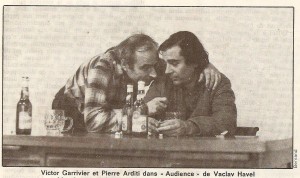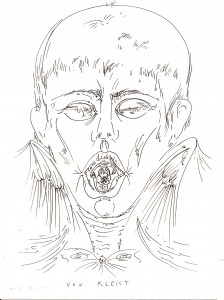« Sur les bords de la Havel, vers le milieu du XVIe siècle, vivait un marchand de chevaux du nom de Michael Kohlhaas, fils d’un maître d’école. (…) Il était propriétaire d’une métairie dans un village dont le nom reste encore le sien. Il y vivait paisiblement de son métier. Aux enfants que lui donna sa femme il enseigna, dans la crainte de Dieu, le labeur et la propriété. Nul entre ses voisins qui n’eût à se louer de sa droiture ou de sa charité. En un mot, force eût été au monde d’honorer sa mémoire s’il n’avait passé les bornes d’une vertu : le sentiment de la justice en fit un brigand et un meurtrier. » C’est ainsi que Kleist pose le terreau sur lequel sa nouvelle se développera en 1808.
Nouvelle qu’Arnaud des Pallières et Jeanne Lapoirie transposent dans les Cévennes, une région qui a connu l’opposition entre les protestants et les catholiques, une région dans laquelle la Résistance fut très présente au cours de la deuxième guerre mondiale. Le preneur de sons, Jean-Pierre Duret, capte — dans les paysages grandioses et montagneux — le ciel, les nuages, le vent, les bruits de la nature et des animaux pour en faire des personnages à part entière. Christelle Berthevas, la scénariste, filme la beauté des chevaux, et cadre — souvent en gros plan — Mad Mikkelsen ombrageux et frémissant comme un pur-sang ; il a toute la grâce d’un héros de Kleist ! Quant aux dialogues écrits par De Pallières, ils ne trahissent pas le style de l’auteur : une phrase, un long silence, une phrase…, des phrases — solennelles, laconiques… et des silences — éloquents. De Pallières s’est aussi permis quelques libertés : il fait une plus grande place à certains personnages (la fille de Kohlhaas par exemple), et en invente d’autres (La Princesse d’Orange du Prince de Hombourg remplace l’Électeur de Saxe !) ; il écarte également une intrigue secondaire à caractère fantastique, facile à retrouver si je vous dis : « la capsule ». Mais sachez que tout ceci rend la nouvelle lisible au spectateur que nous sommes, il faut savoir que l’écriture de Kleist n’est pas une mince affaire !
La particularité de cette nouvelle ne s’arrête pas là. Tout l’art de Kleist — fidèle à son goût pour la musique — a été de l’orchestrer — un peu à la façon du Boléro de Ravel (Penthesilea, elle, était composée comme une sonate…) — en reprenant le motif de la querelle initiale sans cesse grossi de rebondissements, enrichi d’images et de sons générés par les acteurs de plus en plus nombreux. Ils viennent y mêler leurs intrigues et leurs intérêts politiques personnels. Du Kleist !
Michael Kohlhaas — même s’il évoque le XVIe siècle — est une réflexion sur le monde contemporain. Les problèmes, les questions soulevés par le film sont universels : comment appliquer le droit ?, qu’est ce que la justice ?, qu’est ce qu’être juste ?, avoir une éthique ? Le film pose la question du pouvoir, de la manière de l’exercer. Comme nous l’avons souvent démontré dans nos travaux, Kleist est notre contemporain.
Le film fut dans la sélection officielle du Festival de Cannes. Mais c’est lors de la clôture du Brussels Film Festival qu’Arnaud des Pallières obtient le Golden Iris Award.
Ornella, Avignon, le 29 août 2013